En comparant votre diagnostic de performance énergétique (DPE) avec celui de votre voisin, vous vous apercevez que votre consommation d’énergie est identique et pourtant l’étiquette attribuée à votre logement est différente. Pourquoi vous retrouvez-vous avec un F orange alors que votre voisin a un C vert?
Au-delà de recevoir une mauvaise note, les conséquences d’une étiquette qui vire vers le rouge ne sont pas a prendre à la légère: des travaux ruineux en perspective au moment de la vente, l’impossibilité de louer le logement, et à plus grande échelle, si les mauvaises notes se propagent, le risque de voir naître des quartiers entiers officiellement inhabitables. (Lien vers article friches)
A, B, C … : quelle note finale ?
Prenez deux logements voisins quasiment identiques: la même surface, la même isolation, la même consommation de chauffage et d’eau chaude à l’année près, relevé de compteur a l’appui. La différence est que l’un est équipé d’une chaudière à gaz et l’autre d’une chaudière électrique.
Vous avez sans doute déjà rencontré les étiquettes énergétiques lors de l’achat d’un réfrigérateur ou même d’une ampoule. C’est une norme européenne qui classe votre produit dans différentes catégories: A, B, C, D ,E , F et G en fonction de la consommation en énergie finale en KWh (kiloWatt consommé sur une heure).
Et pourtant, quand le diagnostic de performance énergétique est effectué, bien que les consommations soient identiques, les notes diffèrent. Pourquoi? Il faut bien remarquer que contrairement aux produits électroménagers, l’étiquette énergétique d’un logement n’est pas exprimée en KWh mais en KWhep, en “KiloWattheure d’énergie primaire” et ça change tout.

l’Énergie primaire sous l’influence d’un coefficient de conversion
Avant de pouvoir allumer le chauffage, au tout début de la chaîne, il y a les ressources naturelles: le pétrole, le gaz, l’uranium, le bois, le soleil, etc. L’énergie primaire (ep) correspond à l’énergie contenue dans les ressources extraites de la nature, avant leur exploitation et leur acheminement. Après le traitement de ces ressources, on parle d’énergie finale (ef) qui se rapporte à l’énergie livrée au consommateur avant son utilisation.

La distinction entre les deux est importante, parce que pour calculer la consommation complète à la fin de la chaîne (en énergie primaire), il nous faut compter l’énergie dépensée éventuellement à l’extraction et au milieu de la chaîne. Et cela se fait avec la formule suivante:
Energie primaire = Energie finale x Coefficient de conversion.
Le coefficient de conversion est ce qui va compter pour les consommations supplémentaires en ressource naturelle pour que chaque énergie primaire soit utilisable par le consommateur.
Les coefficients d’énergie primaire utilisés en France aujourd’hui sont :

On se rend compte que l’électricité a un coefficient qui va faire grimper le résultat de notre multiplication très vite. En effet, l’électricité ne se trouve pas à l’état brut dans la nature, il faut la produire avant tout, et ça consomme une certaine quantité de ressources naturelles.

C’est donc pourquoi quand on regarde de plus près le Diagnostic Performance Énergétique, on observe que le logement qui utilise un chauffage à l’électricité est déclaré comme 2,3 fois plus énergivore que celui qui consomme du gaz.
En France, exprimer la consommation d’un logement en KWhep, c’est essayer d’exprimer directement son coût en ressource naturelle mais que pour l’électricité.
Le coefficient d’énergie primaire de l’électricité.
Le coefficient de conversion de l’électricité en énergie primaire résulte d’une convention statistique adoptée en 1972 pour permettre de dresser des bilans énergétiques au niveau national. Il prend en compte l’électricité d’origine hydraulique avec l’électricité produite par les moyens thermiques de l’époque (charbon et fioul). Mais ça c’était avant la construction des centrales nucléaires.
En 2020, après des discussions de tout bord, la France a choisi de baisser le coefficient de 2,58 à 2,3 bien que l’union européenne préconisait un coefficient à 2,1 et d’autres « parties prenantes » sa suppression pure et simple.
Mais cette question ne fait toujours pas consensus. Le 11 octobre 2023 une loi proposée en première lecture a été déposée par un groupe de sénateurs dont Mme Sylviane Noël et M Cyril Pellerat. L’objectif visait à supprimer ce coefficient en le ramenant à 1 comme les autres énergies. L’objet de ce dossier législatif s’intitule : Proposition de loi visant à atténuer la crise du logement par une modification rationalisant la méthode de calcul du diagnostic de performance énergétique.
«cette pénalité infligée à l’électricité, décarbonée en France à 92 %, va à l’encontre des objectifs climatiques étant donné qu’un logement chauffé au gaz émet environ 227 g de CO2 par KWh quand le même logement chauffé à l’électricité émet moins de 40 g de CO2 par KWh selon RTE soit un facteur d’émission de 5,7 entre les deux»
Le plus « drôle » c’est que depuis la mise en place de ce coefficient, la France a réussi à atteindre une production électrique très vertueuse, 92% venant de sources décarbonées (émission de co2) en 2021. C’est ainsi que « l’intensité carbone du bouquet électrique français est l’une des plus faibles au monde (36 g CO2/kWh, six fois moins que la moyenne européenne) ». Ce qui donne de quoi discuter la pertinence de la valeur ou même l’existence de ce coefficient.
Rénovation énergétique en mouvement.
Comme le précise l’objet du dossier législatif présenté ci-dessus, garder le coefficient de conversion a 2,3 aggrave la crise du logement. En effet, le coefficient de conversion a pour effet de donner des mauvaises notes aux logements dotés d’équipements électriques. Et puis, d’autres réglementations sont intervenues. Nous savons que le 1er janvier 2025 les propriétaires bailleurs auront l’interdiction de mise en location des classes énergie G, et de même pour les classes énergie F dès 2028, et les classes énergie E en 2034.
Mais il n’y a pas que les propriétaires bailleurs qui sont concernés car la part des propriétaires de résidences principales équipées d’un chauffage individuel « tout électrique » n’est pas négligeable puisque l’on constate qu’il représente 29,6 % des résidences principales au niveau national et 17,9 % dans la région Grand-Est.
De leur côté les propriétaires occupants sont également concernés depuis l’instauration de l’audit énergétique réglementaire en cas de vente d’un bien classée F à compter du 1er avril 2025. Il sera contraint de présenter un parcours de travaux apportant au moins deux classes d’étiquette du DPE après rénovation : travaux d’isolation principalement.
On peut donc conseiller aux propriétaires occupants, si tel est leur souhait, de se décider rapidement de vendre leur bien et de dénicher un acheteur avant le 1er avril 2025 ; ce qui représente peut-être la chose la plus délicate à réaliser sur notre territoire.
Des conséquences non anodines et pas toujours comprises
L’exemple choisi de l’introduction met en lumière à quel point les discussions actuelles sur les consommations d’énergie sont compliquées, voire inintelligibles. Comprendre le concept d’énergie primaire et finale nous aide à avoir une meilleure prise sur la lecture des étiquettes énergétiques, à faire des choix informés sur d’éventuels travaux concernant le mode de chauffage dans son logement. Il nous éclaire aussi sur les débats autour du coefficient d’énergie primaire de l’électricité si notre objectif est bien la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Il faut garder à l’esprit que bon nombre de ces résidences principales pourraient devenir invendables. En outre, on le répète, une grande majorité des locations étiquetées G à partir de 2025, F à partir de 2028 et E à partir de 2034 ne pourront plus être louées. Pourtant ce patrimoine immobilier représente un investissement qui est parfois le fruit du travail de toute une vie.
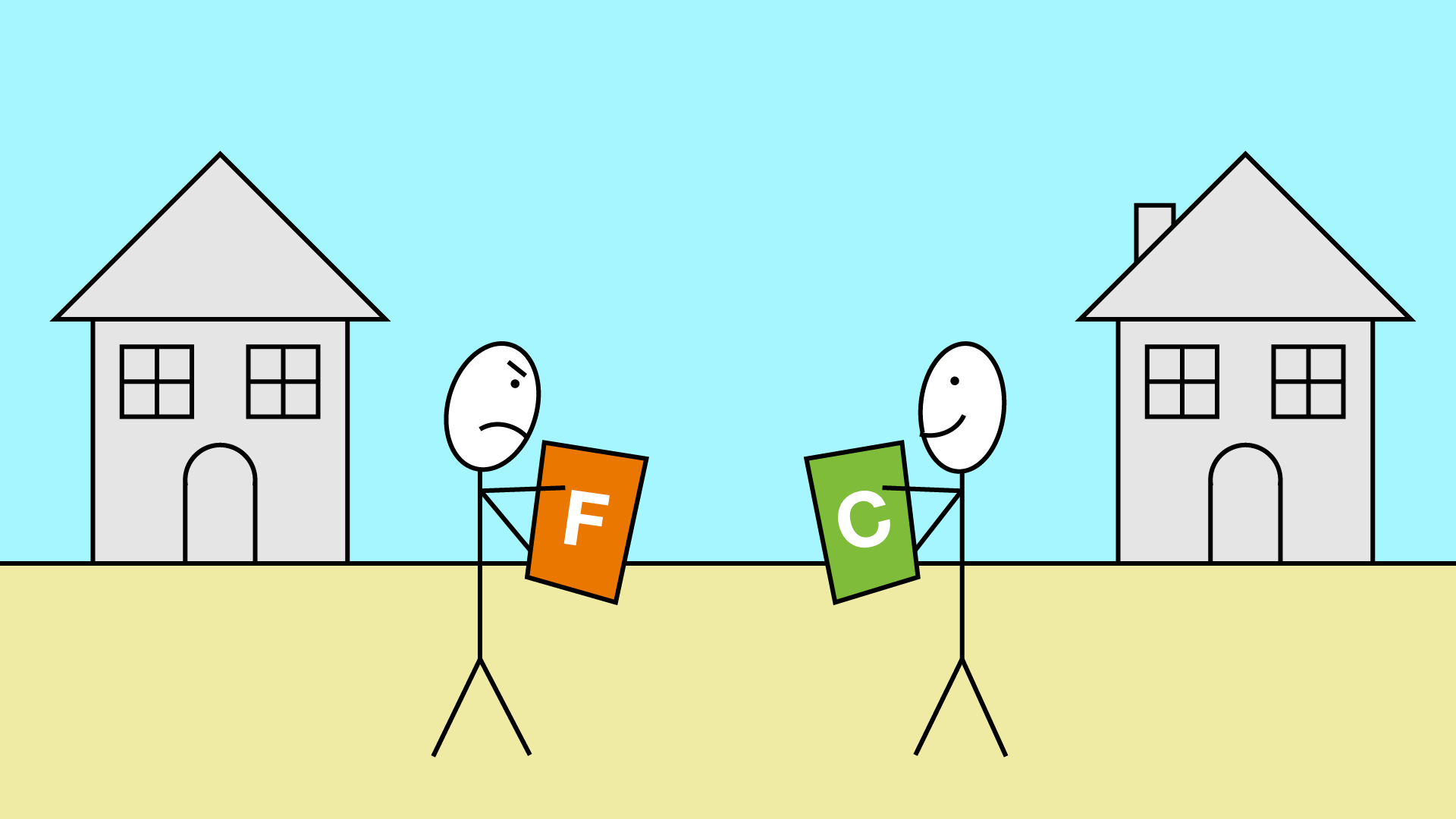
Laisser un commentaire